
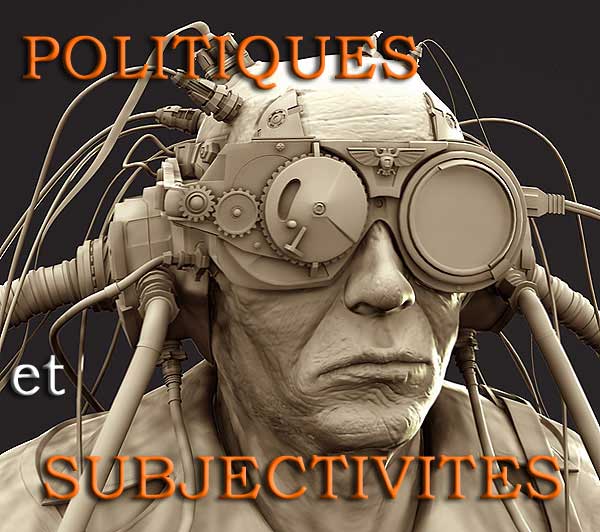
Mercredi
10 JUIN 2009 de 9H à 17H
MAISON
DE L’AMERIQUE LATINE
217,
Boulevard Saint-Germain, Paris, 75007
EVENEMENT
CROMAGNON :
VICTIMES
ET ASSISTANCE A BUENOS AIRES
Cécile
Stola
Le
soir du 30 décembre 2004, « Républica de Cromagnon
», ancienne discothèque devenue salle de concert, en plein
quartier commerçant d’Once, à Buenos Aires, s’est transformée
en un piège mortel où 194 personnes - la quasi-totalité
étant des adolescents - ont trouvé la mort, et d’autres
centaines subissent encore des séquelles physiques ainsi que psychologiques.
C’était
une soirée de fête, la veille du Nouvel An, il faisait beau,
il y avait du monde dans la rue, mais principalement des adolescents qui
s’accumulaient à l’angle des rues Ecuador et Jean-Jaures. Ils étaient
très excités: ils allaient au concert du groupe Callejeros
(les gens de la rue) un groupe de rock à la carrière ascendante.
Partout où ils jouaient, des jeunes d’entre quatorze et vingt ans
s’agglutinaient au pied de la scène. C’est un groupe de rock and
roll de quartier, et les jeunes de classe plutôt populaire revendiquent
à travers eux l’appartenance à un groupe social, et une culture
commune.
Une
sorte de rituel avait été créé par ces fans
pour les accueillir: une pluie de feux de bengale et de feux d’artifice
s’allumaient dès que leurs silhouettes apparaissaient sur la scène.
Les habitudes de matchs de foot se sont mêlés à celle
du rock : les drapeaux, les chants, les feux de bengales. Mais «
Républica de Cromagnon » n’était pas un stade à
ciel ouvert…
«
Arrêtez avec les feux de bengale sinon nous allons tous finir comme
au Paraguay », telle était la demande, prophétique,
d’Omar Chavan, le propriétaire des lieux, aux 3.000 adolescents
attroupés. Il se référait à l’incendie qui
s’était produit cinq mois auparavant dans un centre commercial au
Paraguay dans lequel trois cent soixante quatorze personnes ont trouvé
la mort.

En
dépit de l’alerte du propriétaire et en dépit des
fouilles réalisées à l’entrée, dès que
les Callejeros sont entrés en scène, les feux de bengales
ont jailli. Parmi les dizaines de feux que les jeunes ont allumé,
un feu touche la toile qui recouvre le plafond et en moins de cinq minutes
ce même toit devient un nuage de feu. Quelques secondes de silence,
d’incompréhension, de surréalisme, et puis la panique. Le
noir complet, les cris, la fumée noire épaisse qui émanait
de l’incendie, l’angoisse pour trouver la sortie, le désespoir de
la trouver fermée avec des chaînes et cadenas. Effectivement
la sortie de secours était soigneusement fermée pour
éviter la resquille. Et dans la même logique sadique, les
fenêtres qui figuraient sur le plan d’évacuation avaient été
murées quelques mois auparavant. L’impossibilité de
se déplacer, la compression des uns contre les autres, les chutes,
les écrasements avaient leur cause : Républica de Cromagnon
était habilité pour accueillir 1.031 personnes. Mais ce soir
il y en avait 2.811.
L’organisation
des secours au moment de l’incendie a été fortement récriminée
au Ministère de la Santé. Deux ambulances sont apparues quinze
minutes après la première alerte. Encore quinze minutes plus
tard, des renforts sont arrivées. Le nombre des tubes d’oxygène
a été insuffisant, des survivants ont témoigné
que par moment un tube d’oxygène devait être partagé
à cinq. L’aide spontanée des inconnus des victimes et des
anonymes a révélé à contrario le retard, l’inefficacité,
l’incompétence de ceux, qui devaient diriger et organiser les secours.
L’enquête a montré que 40% des personnes décédées
ont perdu la vie en tentant de sauver d’autres jeunes. Des jeunes qui ont
réussi à sortir de la salle, sont retournés pour chercher
des amis, des êtres chers ou simplement des êtres humains.
Au
fur et à mesure que les minutes passaient, les corps des jeunes
décédés ont commencé à s’empiler dans
un garage à côté de la boîte. Ce garage est tout
de suite devenu une morgue improvisée. D’autres centaines de jeunes
ont été orientés vers les hôpitaux les plus
proches pour cause d’atteintes pulmonaires et de brûlures. La plupart
étaient intoxiqués. Un de ces hôpitaux, était
l’hôpital Rivadavia, où je travaillais en tant qu’interne.
De
la solitude face au chaos à l’invasion chaotique pour le butin cromagnon
Au
moment de la tragédie, je travaillais dans le service de psychopathologie,
plus précisément dans le secteur de psychologie de liaison.
Je suivais des patients hospitalisés dans les différents
secteurs de l’établissement. Ces patients étaient atteints
de pathologies médicales et avaient besoin d’un soutien psychologique.
Je travaillais principalement dans les services de chirurgie, de médecine
et de soins intensifs.
Ce
31 décembre c’était un jour férié, il faisait
très chaud, Buenos Aires était déserté, j’étais
sur le point de partir trouver refuge dans une piscine municipale, lorsque
j’ai entendu à la radio une demande assez alarmante adressée
aux psychologues. Il leur était demandé de s’approcher des
hôpitaux pour soutenir les victimes et les familles de l’incendie
dans le quartier d’Once. Cette alerte était principalement adressée
aux psychologues qui travaillaient à l’Hôpital Ramos Mejia
et Rivadavia. J’avoue que j’ai hésité quelques minutes… mon
sac fin prêt, la piscine, les 39°, 80% d’humidité…
« Bon, j’y passe une petite heure, il y aura sûrement
déjà d’autres psychologues sur place ». Telle était
mon hypothèse car il y avait environ une quarantain de psychologues
qui travaillait à l’hôpital.
Pourtant,
il n’y avait personne. « Enfin ! Merci d’être venu ! Nous avons
énormément besoin de vous ! Il y a des jeunes en état
de choc à l’Unité des soins intensifs, en médecine,
aux urgences, mais il faudrait s’occuper aussi de leurs familles, et des
familles qui vont d’hôpital en hôpital pour trouver leurs proches,
et…il faudrait s’occuper aussi de nous-même ! » C’était
le médecin des urgences, il était débordé.
J’ai
réalisé que la situation était beaucoup plus dramatique
que je l’imaginais. J’ai gardé mon sac de piscine et je me suis
mise à travailler. Mais, par où commencer ? C’était
un chaos. Je devais « intercaler les tâches » :
Ma
première tâche était d’accueillir les familles qui
arrivaient pour chercher leurs fils et filles adolescents, les accompagner
à l’unité de soins intensifs à fin qu’ils puissent
identifier si parmi les jeunes hospitalisés se trouvait le leurs.
Ces
mères, pères, frères, sœurs, arrivaient avec la douloureuse
frustration de ne pas avoir pu les trouver à l’hôpital Ramos
Mejia, où sont allés la plus part des victimes car c’était
l’hôpital le plus proche de la boîte, (à peu près
700 m), mais avec l’espoir infini de les retrouver dans cet établissement.
Durant le trajet qu’il fallait faire pour aller jusqu’aux lits ils me prenaient
fortement le bras ou la main de manière totalement spontanée.
Une fois que nous étions devant le lit la réaction était
corporellement significative: si entre les fils, les tubes et les appareils
se trouvait leur fils, leur soeur, leur proche qu’ils cherchaient désespéramment,
alors ils lâchaient ma main ou mon bras pour me prendre dans les
leurs, en pleurant de soulagement.
Si
malheuresement le visage de la victime n’était pas celui de
leur proche, soudainement la pression qu’ils exerçaient sur ma main
se débilitait complètement, la frustration et la douleur
éteignaient la force pour quelques instants. Je devais alors les
accompagner à l’entrée, où d’autres familles attendaient
le même rituel, et leur expliquer à quels hôpitaux ils
devaient ensuite se rendre, c’est-à-dire là où d’autres
victimes avaient été transférés. Malheureusement
les options étaient assez limitées. Le parcours continuait
à l’Hôpital Penna, puis à l’Hôpital de Clinicas,
et finalement, le fantôme le plus terrifiant : la morgue judiciaire,
où plus de 180 corps attendaient d’être identifiés.
Ma
deuxième tâche était de m’occuper de soutien des survivants
Dès
que je me présentais en tant que psychologue auprès d’eux,
ils exprimaient assez compulsivement l’horreur vécue quelques heures
auparavant. J’ai pu récupérer quelques extraits de leurs
récits.
*
Un jeune de 17 ans : «J’entends encore les cris qui résonnent
dans ma tête "mon gars, demain c'est le nouvel an, je veux
sortir, j'ai des enfants", Tout le monde criait, je ne pouvais pas
bouger, les gens me marchaient dessus, je me suis fait écraser
»
*
Une fille d’une quinzaine d’années : « Je me suis mise à
pleurer désespérément, je me disais: "maman, sort
moi d’ici! je voulais sortir et voir ma mère. Je me disais: s’il
m’arrive quelque chose, elle va en mourir et je ne voulais pas qu’elle
meurt. Je devais sortir. Je ne pensais qu’à elle »
*
Un garçon de treize ans : « J’étais en train
d'écouter du rock, c’était la fête, et dix minutes
après, je me suis retrouvé par terre, à l’extérieur,
entouré de personnes mortes. On a cru que j’étais mort et
on m’a mis parmi les corps. Je vais devenir dingue”
*
Une adolescente, de seize ans : « Je tournais en rond, parce qu’il
n’avait pas de panneau de sortie de secours. Soudain, j’ai entendu quelqu’un
crier qu’il avait trouvé une porte, j'essayais avec lui de l'ouvrir
désespérément, mais elle était fermée
et je me brûlais, parce qu'elle était en fer. Donc j’ai du
la lâcher. Là, je me suis dit, ça y est, c’est la fin…et
j’ai commencé à prier. Juste à ce moment là,
on a ouvert la porte, j’ai vu une lumière et je me suis dit: "qu’est
ce que c’est? La sortie ou le ciel ? Je ne savais pas si j’étais
morte ou si j’allais sortir. Madame, je suis vivante, n’est-ce pas ?»
Enfin,
ma dernière tâche était d’accompagner des familles
des victimes hospitalisées, ce qui n’était pas la tâche
la plus simple.
Tous
les récits étaient imprégnés du sentiment d’irréalité,
de la violence du choc, de l’angoisse face à la mort imminente.
Que faire avec toutes ces émotions, tous ces vécus, toutes
ces souffrances inattendues ?
Quelques
heures plus tard, bien que j’eus l’impression que plusieurs jours s’étaient
écoulés, une collègue est venue m’aider. Maintenant
on était deux, tout changeait pour moi…
Nous
avons travaillé en équipe avec les autres médecins,
jamais il n’y eut une demande si intense de prises en charge psychologique
venant des médecins. Mais jamais autant de psychologues n’ont manqué.
J’éprouvais une revalorisation de mon métier, alors que je
n’ai jamais été aussi désorientée. Il fallait
travailler dans l’improvisation, l’incertitude, la créativité.
Je me souviens en particulier, du cas d’un garçon de moins de quinze
ans hospitalisé en soins intensifs. Il était 21h et personne
n’était venu pour lui. Son état était critique,
il était inconscient et son pronostique était mauvais. Un
mal-être inondait toute l’équipe, il était difficile
de voir ce garçon si isolé lutter pour survivre. Qu’est-ce
qu’on pouvait faire ? Un des médecins eût une idée,
géniale pour les uns, irresponsable pour les autres. Nous avons
voté.
Sa
proposition a gagné. On a pris ce garçon en photo et on l’a
envoyée à une chaîne d’information. Vingt minutes plus
tard, la photo apparaissait sur tous les écrans. Deux heures après,
sa mère était à ses côtés. Cette rencontre
nous a permit de finir cette longue journée, et l’année 2004
avec un peu plus de courage.
C’est
dans un silence inhabituel pour la ville de Buenos Aires, que le réveillon
s’est terminé. La raison : le gouvernement de la ville a interdit
les spectacles et les feux d’artifice en signe de deuil.
Pour
ma part, je passais mes journées entières à l’hôpital,
heureusement accompagnée de mon chef de service, un psychiatre qui
nous supervisait et qui s’occupait de la prise en charge médicamenteuse.
Au jour le jour les liens avec les patients hospitalisés, pas plus
d’une dizaine après le cinquième jour, se construisaient
progressivement.
Mais,
une semaine plus tard, les vacances de noël finies, une scène
surréaliste s’est répétée: au moment d’arriver
au lit du patient, celui-ci me portait un regard plein d’étonnement
et me disait: « il y a une heure une dame est venue se présenter
comme ma nouvelle psychologue, vous n’allez plus vous occuper de moi ?
». Eh oui, « cromañon » est devenu le «
hit » de l’été que tout psy voulait avoir dans son
parcours clinique.
Subitement
tous les secteurs appartenant au service de psychopathologie se sont déclarés
« responsables de la prise en charge psychologique des victimes
de cromagnon ». Les victimes se sont transformées en une sorte
de butin de guerre qui a déclanché des fortes rivalités
au sein de l’équipe de… santé mentale. Heureusement, les
patients étaient écoutés et on a pu continuer à
travailler ensemble durant leurs hospitalisations.
Suite
à leurs sorties, sauf cas très particuliers, on a du les
orienter vers l’équipe qui s’occupait de la prise en charge psychologique
des adolescents.
Malheureusement,
la rivalité ne s’est pas limitée aux différents secteurs
intégrant un même service. Une sorte de concurrence inter
hospitalière s’est installée silencieusement. Les mots «
décès », « aggravation », « impuissance
», sont devenus politiquement incorrects. Il fallait avoir des «
sorties de victimes de cromagnon », pas de morts.
Tous
les yeux du pouvoir médiatique et politique étaient fixés
sur les hôpitaux s’occupant des survivants. Comme par magie, du matériel
médical jamais vu auparavant est apparu, mais attention : que pour
les « patients de cromagnon », c’était une gentillesse
du gouvernement. Il ne fallait surtout pas augmenter la colère des
familles envers M. le Maire. Peut-être une « prise en
charge exceptionnelle » de la part des hôpitaux publics adoucirait
leur rage.
Conséquences
politiques, sociales et subjetives de l’événement Cromagnon
Mais
non. Cette entreprise du gouvernement de la ville, de dissuader les familles
de victimes, échoua. Le maire de Buenos Aires Anibal Ibarra a été
écarté de son poste le 14 novembre 2005 après que
l’organisation des familles et amis des victimes ont réussi á
le traîner en justice pour mauvaise administration. Jamais
dans l’histoire politique de Buenos Aires un maire avait été
destitué par le vote des législateurs.
D’autre
part, Omar Chaban, propriétaire de la salle « Républica
de Cromagnon » a été emprisonné, puis libéré
et risque actuellement plus de vingt ans de prison pour ravage suivi de
décès. Les membres du groupe Callejeros, en tant qu’organisateurs
et responsables de la vente des entrées risquent la même peine
sous les mêmes accusations. Le prochain 19 août les juges
présenteront leurs sentences.
D’autre
part, la boîte Republica de Cromañon a subi quelques changements
de statuts. De salle de concert elle est devenue chambre à gaz pour
finir en sanctuaire.
Il
ne s’agit pas d’une métaphore pour choquer les esprits. Durant le
procès le médecin légiste Osvaldo Raffo a comparé
l’événement dans la salle « République de Cromagnon
» aux tueries dans les chambres à gaz nazies durant la deuxième
guerre mondiale. Effectivement, l’acide cyanhydrique dégagé
par le toit en flammes de la salle de concert, était le même
poison que les nazis avaient choisi pour la vitesse et l’efficacité
avec lesquelles il est absorbé par la peau ainsi que par les voies
respiratoires, éliminant les cellules des voies aériennes
de forme immédiate. Tous les décès ont été
provoqués par l’inhalation de la fumée, personne n’est mort
à cause des brûlures ou des écrasements, a confirmé
le médecin légiste. Et le fait que la salle était
fermée a potentialisé les effets des gaz toxiques.
Quelques
heures après cet enfer, des baskets, des t-shirts, des photos qui
sont restée dispersés autour de la salle brûlée,
ont été lentement rassemblés. Plus tard des
lettres, des dessins et d’autres photos ont été rajoutées.
Quelques jours après, cet enfer au milieu du quartier de la gare
de Once est devenu spontanément un sanctuaire où les familles
des victimes se réunissent et partagent leur douloureuse incompréhension.
Peu à peu, cet espace s’est chargé de subjectivités.
Le sanctuaire permet d’ouvrir un espace symbolique, de donner du sens à
la violence, au vide, de reconstruire ce qui a été détruit.
C’est un endroit qui conserve la présence de ceux qui sont partis
ce soir-là, qui évite la désintégration, qui
soutient la lutte collective pour que justice soit faite.
Le
devenir de cet espace public ne laisse pas indifférents tous ceux
qui pleurent leurs enfants arrachés. L’actuel maire de Buenos Aires,
Mauricio Macri, a le projet de rouvrir la rue Ecuateur, où se situe
le sanctuaire, mais la réponse des familles est unanime : la rue
ne se négocie pas. C’est là-bas que les jeunes ont eu leur
dernière joie, leur dernier sourire, avant la douleur et l’horreur.
L’argument du maire soutenant que cette rue constitue une artère
principale pour le transit urbain ne les convainc pas : leur artère
principale est partie ce soir là, répondent-ils.
Quatre
ans et demi se sont écoulés. Différentes façons
de nommer l’incompréhensible ont vu le jour. « Massacre de
cromagnon » est le terme choisi par les familles des victimes. Pour
eux les responsables ont clairement tué avec sauvagerie et en masse
des êtres qui ne pouvaient pas se défendre. A l’opposé,
le gouvernement de ce moment-là préfère utiliser le
mot : Accident, de cette façon ils soulignent l’imprévisibilité
de l’événement, et par conséquence la non responsabilité.
J’ai bien apprécié la réflexion faite par
la philosophe et sociologue argentine, Maristella Svampa. Pour elle
l’événement Cromagnon ne peut pas être considéré
comme une catastrophe au sens propre du mot, car, même s’il présente
un caractère collectif, il n’a pas été marqué
par l’intentionnalité des acteurs. Cromagnon, selon l’auteur,
démasque un croisement pervers entre la précarité
- en tant que modèle généralisé des rapports
sociaux- et l’exclusion de la jeunesse, conçue comme
une population résiduelle. L’événement Cromagnon dévoile
une société où gouvernent les règles du jeu
d’un capitalisme « flexible » (du travail instable, des journées
de travail éternelles, de l’incertitude sur l’avenir) des
règles installées à partir des années 90, avec
la complicité des fonctionnaires corrompus et des entrepreneurs
obsédés pour remplir leurs comptes bancaires, des règles
qui ont abouti à la configuration d’une matrice criminelle.
Cromagnon a révélé aussi les complicités des
groupes de pouvoir et la place réservée à la jeunesse
populaire, dépouillée des droits à la protection,
à la sécurité, à la vie. Mais en même
temps, et heureusement, l’événement cromagnon a montré
que, face à la souffrance, il y a encore une réponse immédiate,
solidaire et démesurée de la part des inconnus, de
citadins ordinaires. Face à l’injustice, il y a la lutte infatigable
des familles, des amis, et d’une partie du peuple, qui ont réussit
à mettre des limites à l’impunité politique, et à
envoyer aux tribunaux les bourreaux du pouvoir.
Maintenant
c'est à la justice de parler, en espérant des peines justes
qui ouvriraient les portes à une réparation symbolique fondamentale
pour les victimes. En espérant que la société
commence à générer des politiques qui contribuent
à configurer une conscience collective de prévention. Que
le droit à la vie des jeunes, et de tous soit respecté, valorisé.
Que la corruption et les négligences qui ont abouti à la
perte de 194 vies soient démantelées. Pour passer du souhait
à l’acte : que justice soit faite, qu’elle soit respectée
et qu’elle ne pas oubliée
