
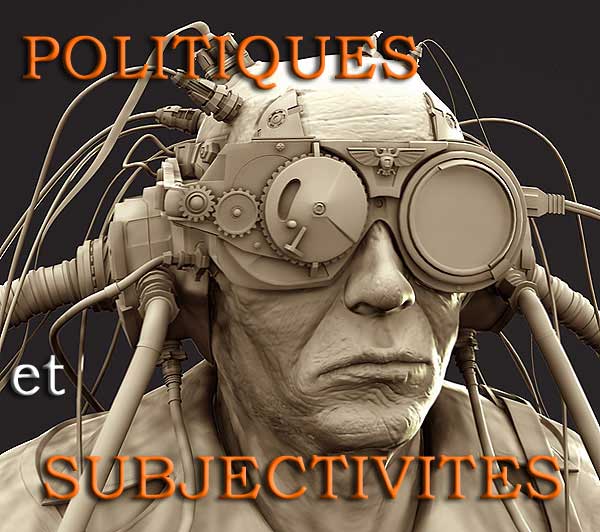
Mercredi
10 JUIN 2009 de 9H à 17H
MAISON
DE L’AMERIQUE LATINE
217,
Boulevard Saint-Germain, Paris, 75007
UNE
PARANOÏA DE GRACE
Eduardo
Mahieu
Ma
troppo dura legge,
Legge
scolpita in rigido diamante,
Contrasta
a’ preghi tuoi, misero amante
Eurydice,
Peri
Il
n’est pas habituel que le bureau de consultation d’un Centre médico-psychologique
puisse évoquer le parterre d’une salle d'opéra. Ce n’est
pas fréquent non plus qu'à son sujet l’on associe un mirador.
Et pourtant, dans le cas d’une patiente venue consulter au C.M.P., l’amour,
la folie, la punition ou la grâce que l’opéra ne cesse de
mettre en scène, mais aussi la duplicité de structure de
la loi et ses rapports avec le pouvoir souverain, ont donné un brille
particulier à ses expressions cliniques. Son histoire nous a permis
de confronter ses parentés et différences cliniques avec
la paranoïa d’autopunition de Jacques Lacan [10], tout autant qu’avec
l’état d’exception que Giorgio Agamben théorise dans notre
horizon politique contemporain [1]. Ce cas, assez inusuel à nos
yeux, a mis en scène une « guérison » sur le
mode d’un lieto fine relevant plus d’un libretto du poète Métastase
que des bons soins psychiatriques, grâce à l’intervention
d’une figure du pouvoir souverain, le Maître démocratique
à l’époque de son déclin.
Un
prélude d’opéra
Des
philosophes et psychiatres [13, 14, 16] qui s’intéressent à
la politique se sont intéressés à l’opéra.
Ayant pris naissance dans l’univers de l’absolutisme, l’opéra a
traversé les périodes de profonds changements politiques
qui ont vu naître les formes contemporaines de la subjectivité.
Les philosophes montrent un intérêt particulier pour Mozart
du fait que ses oeuvres se retrouvent à la charnière du passage
du pouvoir du Maître de l’âge classique à celui qui
naît avec la Révolution française et le sujet citoyen
autonome. Il montre, avec l’ironie qui le caractérise, les embrouilles
et démêlés entre l’autonomie du sujet et la grâce
du souverain au statut d’exception.
Selon
ces auteurs, une matrice essentielle, un dispositif minimal, règle
l’action dramatique de l’opéra: le lamento, ou suplicatione,
expose la subjectivité nue du sujet qui fait appel à l’Autre,
à son statut sublime, afin de l’émouvoir et d’obtenir sa
grâce par un geste au-delà de la loi, confirmant ainsi sa
position d’exception. La fonction de la musique est précisément
d’agir sur l’Autre divin ou son représentant terrestre pour éveiller
son amour et susciter une réponse. L’ensemble du dispositif est
mis en scène pour un redoublement du regard de l’Autre, à
la fois interne au libretto, mais aussi pour le souverain terrestre qui
regarde l’oeuvre. Deux formes sont classiquement distinguées : d’un
côté l’opéra seria, qui prend son essor pendant la
période de l’absolutisme, dont la matrice essentielle est la tragédie.
En contrepoint, l’opéra buffa, qui apparaît comme un genre
plus démocratique, où les différences de classe Maître/esclave
tendent à se résoudre dans l’établissement d’une commune
humanité par le biais de la comédie. Nos philosophes indiquent
que ces importants changements politiques, à la croisée épocale
de ces deux univers ontologiques, entraînent des conséquences
sur la subjectivité des personnages ainsi que sur les différents
régimes de jouissance lyrique, produisant un déplacement
d’intérêt de la trascendence de l’ordre symbolique à
l’immanence de la jouissance de la vie [16]. Sans oublier la jouissance
du regard de l’Autre pour qui le spectacle se joue, toujours dédoublé,
incarné par l’aristocratie et ses représentants olympiens,
ou plus tard par la bourgeoisie, ou encore disséminé
dans des figures de la science telles les philosophes ou les médecins.
Si
nous nous intéressons à cela ici, c’est que le sol anthropologique
commun de l’imagination et de la création humaines, qui peut aller
de l’opéra à la folie, éclaire d’une lumière
particulière la scène de notre pratique quotidienne, dans
le décor imposé par notre temps im-politique. Dans le cas
clinique que nous allons évoquer, nous avons occupé pour
ce qui est du politique la place d’un sujet supposé savoir
à la fois trop et pas assez aux yeux de notre patiente, mais aussi
celle d’un sujet supposé tout surveiller et tout dire aux oreilles
des autorités souveraines. Et sur un contre-plan proprement clinique,
cette lumière nous montre que si la tragédie relève
de l’autopunition, la grâce relève de la farce ou la comédie,
avec des effets décisifs pour un cas qui implique, comme dans un
bon libretto, les plus hautes sphères du pouvoir terrestre.

Alcina
Voici
l'histoire : Alcina arrive en mai 2003 au Centre médico-psychologique
où nous travaillons à l’époque, adressée pour
dépression par une assistante qui s’occuppe d’elle. Cette première
rencontre semble très éprouvante. Elle pleure et s’interrompt
à chaque fois qu’on sollicite des précisions sur sa narration,
véritable lamento énigmatique à plusieurs égards.
Alcina, femme d’une cinquantaine d’années, travaille comme concierge
depuis deux ou trois ans dans une résidence distinguée de
la banlieue parisienne. Elle sort de prison où elle à séjourné
pendant trois mois à la suite d’une histoire assez confuse. Ce qui
l’a conduit en prison est le vol du chéquier d’une des résidentes.
Munie de ce moyen d’achat si personnel, elle se rend à la boulangerie
où elle est une cliente habituelle, tout comme la résidente,
et achète une demi-douzaine de croissants devant les yeux médusés
de la boulangère. Pour ces faits, elle a été condamnée
à six mois de prison dont trois fermes, et envoyée à
Fleury-Mérogis « avec les criminels », comme elle le
dit. Elle n'est pas capable de dire grand chose de ce séjour et
décrit de façon assez brumeuse un état psychique ressemblant
à un syndrome de Ganser, pour lequel elle a reçu un traitement
médicamenteux qui lui a fait prendre une dizaine de kilos. A la
suite de cet épisode, elle est libérée avant le délai
prévu par la loi. Une fois sortie de prison, un cancer des ovaires
et de l’utérus se déclare, ainsi qu’une aphonie importante
liée à des polypes des cordes vocales qui la laisse pratiquement
sans voix, ce qui ajoute à son récit une note pathétique
supplémentaire. Alcina se dit dans un profond désarroi et
nous prie de ne jamais prendre contact avec le Service médico-psychiatrique
régional pénitentiaire (S.M.P.R.), car elle ne veut plus
rien savoir de son passage par la prison, ni de la justice, qu’elle considère
comme défaillante et injuste. La rassurant sur cette question, nous
insistons cependant pour que, de cet acte si curieux et qui réussit
« par voie de contrecoup social » [10] de façon si lourde
de conséquences pour elle, elle nous dise un peu plus.
Le
gardien et son trésor
De
son discours, toujours entrecoupé de pleurs, de zones d’ombre, de
contradictions et de silences, nous arrivons à reconstruire une
ébauche d’histoire clinique. De son enfance nous n’obtenons que
des généralités : ses parents ont divorcé lorsqu'elle
avait 5 ans. Elle décrit sa mère comme une femme alcoolique
avec qui elle a entretenu des rapports très difficiles. Puis, à
quelques mariages ont suivi quelques divorces, et elle est aujourd’hui
mère de deux filles et grand-mère de quatre petits enfants.
Alcina nous raconte qu’elle a été hospitalisée à
plusieurs reprises dans des cliniques pour des « chocs émotionnels
». Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans
une institution constituant un rouage essentiel de l’ordre économique,
où elle était considérée comme employée
modèle aux yeux de « Mr Troutchon », président
de cette institution (dont elle dit « qu’il a un nom »). C’est
à travers des signes discrets qu’elle entendait jouir de la préférence
de ce haut personnage, dont elle savait toujours son regard toujours posé
sur elle par le truchement des nombreuses caméras du bâtiment.
De façon plus discrète, elle nous fait comprendre qu’elle
correspond aux sentiments de cette personne, destinée plus tard
aux plus hautes sphères d’institutions économiques au niveau
continental, encore plus décisives pour le sort de millions de personnes.
L’action
dramatique de son cas se déclenche un jour de 1997 lorsque, sans
qu’elle puisse nous en dire davantage, elle met la main sur le trésor
gardé jalousement en sécurité dans les entrailles
du bâtiment. Grâce à son statut d’employée modèle
et des sympathies qu’elle sait éveiller autour d’elle, elle réussit
à tromper le panopticon télévisuel et s’empare de
cinquante millions de francs qu’elle place aussitôt dans le coffre
de sa modeste voiture garée sur le parking de l’institution. Puis,
elle rentre chez elle et, sans toucher le moindre billet, revient le lendemain
pour se garer comme d’habitude sur le parking, avec le trésor dans
le coffre. C’est alors qu’elle est arrêtée pour la première
fois. Cet acte laisse perplexes et incrédules les spectateurs de
l’épisode. C’est ainsi que, malgré (ou à cause de)
l’évidence d’un mécanisme opaque à l’oeuvre, ainsi
que de l’absence de tout sens commun d’un acte qui voudrait qu’on
se fasse la belle avec le magot comme dans un bon film d’action, un procès
très discret a lieu dans un souci un peu confus de protection de
l’employée modèle. Alcina se voit condamnée à
un an de prison avec sursis, ce qu’elle-même considère encore
aujourd’hui comme étant, même injuste, un traitement de faveur.
Elle acquiert ainsi la certitude de la bienveillance des hautes figures
à son égard, en même temps que celle d’une justice
inconsistante, partielle, voire capricieuse.
L’innocence
à tout prix ou l’autopunition
Cependant,
pendant notre entretien son innocence ne fait aucun doute pour elle. Avec
la même finesse que celle à l’oeuvre dans « l’argument
du chaudron » rapporté par Sigmund Freud, elle nous explique
qu’à cette période de sa vie elle était sous Prozac,
prescrit par « eux » : les médecins. Que donc n’étant
pas « elle-même », elle ne savait pas ce qu’elle faisait.
Mais aussitôt, elle nous donne une deuxième version : il serait
possible qu’on ait agi par vengeance sur sa personne, puisqu’elle était
jalousée à cause des faveurs si haut placés dont elle
faisait l’objet. Enfin, après un temps d’hésitations et de
pleurs, elle nous dit qu’elle aimerait voire les bandes vidéos de
l’événement, car elle n’arrive pas à se croire l’auteur
d’un tel acte. Pour Alcina, la preuve du doute est constituée par
le jugement bâclé dont elle se considère l’objet. Après
ce récit, sollicité parfois avec insistance et livré
non sans peine, elle se trouve devant nous dans un désarroi profond,
effondrée et désespérée. Son monde a pris la
tonalité d’une catastrophe, mais elle reste sans aucune explication
pour le deuxième acte. Comme inspirée par Métastase,
son récit emprunte une nouvelle fois la figure du lamento et nous
demande avec insistance la prescription d’un traitement médicamenteux
pour l’apaiser, car dans son désespoir elle n’a plus envie de vivre.
Alcina nous dit prendre sans aucun effet un traitement par antidépresseurs
et anxiolytiques prescrit par son médecin généraliste.
Nous convenons plutôt de nous revoir rapidement.
Si
comme Marx l’a fait remarquer, Hegel affirme que dans l’histoire la répétition
se fait la première fois sur le mode de la tragédie et la
deuxième sur le mode de la farçe, dans cette histoire nous
sommes à première vue dans une inversion du célèbre
schéma. C’est plutôt vers le mécanisme d’autopunition
de l’Aimée de Jacques Lacan que nous nous tournons, en même
temps que nous constatons là-aussi des dissemblances. Contrairement
à Aimée, le dénouement aux allures tragiques des événements
ne semble pas lui apporter le moindre réconfort. Ni le crime ni
le châtiment ne semblent être subjectivés de la manière
présentée par Aimée. Pourtant, les éléments
semblent à plusieurs égards se correspondre. Lacan revient
à plusieurs reprises dans sa Thèse au classique délire
de relation des sensitifs décrit par Ernst Kretschmer [9], ce qui
nous semble aussi illustrer au mieux le style clinique actuel de notre
patiente. Nous pensons que l’insistance de Lacan est due au fait que c’est
là qu’il trouve les meilleurs arguments pour expliquer la «
guérison » du délire de sa patiente par voie de «
contrecoup social » [10]. Dans ce tableau, Kretschmer distingue trois
éléments cliniques décisifs : le caractère
de la personne, l’événement vécu et le milieu social.
Pour cet auteur, ces sujets sont à coup sûr des victimes prédestinées.
Cependant, Kretschmer affirme que l’expérience décisive,
avec la situation vitale qui la sous tend, constituent tout : « Otez-là
et la maladie serait réduite à rien » [9]. Mais, pour
Lacan, l’intérêt des mécanismes psychiques d’autopunition
qu’il essaye de mettre en lumière est de démontrer qu’ils
ont une genèse sociale, dont la condition interne est la satisfaction
de la pulsion autopunitive, mécanisme tragique s’il en est un. La
malade a réalisé son châtiment : elle s’est frappée
elle-même. Lacan est surpris que tout le délire, ses thèmes
d’idéalisme et d’érotomanie, de persécution et de
jalousie, « le bon comme le mauvais » [10], tombent d’un seul
coup. Et, pour insister sur ce versant social, voire politique, il dit
qu’il n’est pas inconcevable que lors d’une époque moins sceptique
que celle de sa patiente, comme par exemple une ambiance sociale de «
fanatisme moralisant », elle aurait pu passer pour une sorte de Charlotte
Corday. Ainsi, si l’esprit politique de l’époque peut infléchir
le sens de l’acte, on peut imaginer que les événements ne
suivent pas les mêmes renversements dans le cas d’Alcina puisqu’ils
se déroulent dans une époque aussi sceptique mais bien plus
cynique.
Chez
notre patiente, rien ne semble marcher de la sorte. Après la prison,
ses lamentations ne font qu’augmenter d’intensité. Devant ces éléments
dépressifs, nous cédons à notre propre réticence
et lui prescrivons un traitement anti-dépresseur reconnu pour sa
puissance : il s’est avéré sans aucune efficacité.
D’ailleurs, la patiente, qui a repris sa loge dans la résidence
où elle continue de travailler, commence à se vivre de plus
en plus sous un regard accusateur : toujours à des signes discrets,
elle voit qu’on parle d’elle, qu’on la pense coupable : « je vis
toujours dans les lieux du crime », dit-elle, « ça cause
dans l'immeuble ». Pire encore, elle prend des airs d’intrigante
raffinée, selon l’expression de Kretchsmer, lorsque se retrouvant
en arrêt maladie, elle se montre parée de lunettes noires
sur les terrasses de café de cette ville coquette, exposée
et masquée au regard accusateur des résidents : « ils
ne comprennent pas que je sois en arrêt de travail », se défend-t-elle.
Peu de temps après l’éveil de cet état d’esprit, elle
nous dit recevoir dans sa loge des menaces anonymes. Son médecin
de travail semble convaincu et préconise un changement de poste.
Les regards accusateurs se disséminent, reviennent dans des bouts
de papiers, des gestes discrets, des sous-entendus. La prescription d’un
traitement neuroleptique n’y fait rien, encore une fois. Alcina nous dit
envisager de mettre fin à ses jours, victime d’un procès
injuste et incompréhensible à ses yeux. Un bref séjour
dans une unité pour patients anxio-dépressifs tempère
un peu ces idées, mais la tension psychique subsiste. L’autopunition
semble s’éterniser, s’universaliser, devenir illimitée. Son
lamento aux allures dépressives ne trouve pas de réponse
pertinente chez les multiples assistants qui l’entourent, devenus si semblables
à ceux que Walter Benjamin [4] reconnaît omniprésents
dans les romans de Kafka, personnages crépusculaires et inachevés
qui ne peuvent apporter quelque assistance que ce soit. Son libretto prend
alors une tournure kafkaïenne décidée.
Les
portes de la Loi : biopolitique et soins d’exception
La
référence à Kafka ne s’avère pas une simple
figure de style. Slavoj Zizek [17] a noté que ce qui caractérise
cet auteur ce n’est pas tant un style d’écriture unique mais un
regard innocent sur l’édifice de la loi, un regard qui pratique
une torsion permettant de percevoir une machinerie de jouissance obscène
dans ce qui auparavant apparaissait comme le digne édifice de l’Autre
légal. C’est ce qui se fait jour quelques mois après que
notre patiente soit venue consulter, lorsqu’un événement
inattendu vient faire bondir la situation : Alcina se voit communiquer
par le tribunal qu’il y a eu erreur dans le traitement de son dossier et
qu’elle a été libérée de façon indue,
et se doit de compléter sa peine de prison ferme. Ce retournement
est dû à un changement de juge dans son dossier, changement
qui intervient en même temps qu’un changement du pouvoir politique
local, mais aussi à un changement plus global d’un esprit politique
promis à un avenir national, qui ne fait rien d’autre que courir
à la recerche du temps perdu de la mondialisation. L’angoisse de
notre patiente commence à la dépasser. Sa certitude dans
la faillibilité de la justice se renforce par la lettre même
de ses fonctionnaires assistants, mais en même temps cela vient signifier
qu’elle est contrainte de retourner en prison. Pour la première
fois dans ses démêlés avec la justice, une expertise
psychiatrique est demandée par le tribunal. Elle conclut à
l’incompatibilité de son état de santé avec un séjour
dans un établissement pénitentiaire. A la confusion de la
situation se mêle l’obstination de fonctionnaires assistants déterminés
à faire respecter les normes. On lui propose alors ou bien le port
d’un bracelet électronnique, ou bien... C’est à ce moment
que nous sommes interpelés au téléphone par une voix,
que nous pourrions appeler acousmatique selon l’expression de Michel Chion
[5], visant à nous faire monter sur la scène politico-juridique.
Le
coup de téléphone est en provenance d’une assistante du Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (S.P.I.P.) avec le propos
de nous soumettre une proposition de « Convention individualisée
» dans le cadre d'une « Convention de placement à l'extérieur
sans surveillance continue du personnel pénitentiaire ». La
voix s’adresse à notre bon sens tentant de nous convaincre que faute
de signature de ladite convention, Alcina devrait retourner en prison et
que cela lui porterait préjudice sur le plan de sa santé,
ce que la justice ne souhaite pas. Plusieurs coups de téléphone
ont suivi jusqu’à ce que nous demandions à voir ce document,
pour dépasser le moment d'étonnement dans un moment pour
comprendre. Le modèle de la « Convention individualisée
» nous a été transmis par fax avec le papier en tête
du Ministère de la Justice, dont nous citons intégralement
les points nous concernant :
«
* Le Service d'Insertion et de Probation est chargé à la
demande du juge de l'application des peines du suivi et du contrôle
des personnes exécutant leur peine dans le cadre d'un placement
extérieur sans surveillance continue du personnel pénitentiaire.
*
La prise en charge et l'accompagnement médical et psychologique
réalisés par la structure désignée dans la
présente convention individualisée sont le pivot de la prise
en charge. L'objectif consiste à assurer la continuité des
soins. La structure peut être amenée à prescrire des
médicaments, un séjour hospitalier, ou à démarrer
ou poursuivre une psychothérapie.
*
Tous incidents doivent être signalés sans délai au
travailleur social référent du S.P.I.P., charge à
lui d'informer, dès connaissance, le juge de l'application des peines.
En cas d'impossibilité de joindre le travailleur social référent,
la structure s'adressera à la direction du S.P.I.P. ou au travailleur
social de permanence au S.P.I.P.
*
La présente convention est conclue entre monsieur le directeur du
Service Pénitentiaire d'Insertion et des Probations, ou son représentant
et Mr X du Centre médico-psychologique »
Ce
court document contient, comme la partition conducteur d’un opéra,
l’ensemble de ce qui est en jeu dans l’esprit du temps. Il met à
jour de manière caricaturale la véritable nature de la biopolitique
: par une sorte de transsubstantiation curieuse, la justice se réclame
de la continuité des soins pour proposer aux sujets supposés
soignants la continuité de la surveillance. Le côté
obscène et orwellien se donne à voir par la proposition insistante,
et prétendument bienveillante, émanant du Ministère
de la Justice de signer une convention en tous points hors-la-loi, comme
si le lamento de notre patiente était en train d’agir sur les nerfs
des fonctionnaires assistants. La novlangue [15] utilisée pour évoquer
la « structure » agent de la convention, assombrit étrangement
un lieu de soins qui bascule subrepticement dans la liste des appareils
idéologiques d’état établie par Louis Althusser [3].
Devant ce décor d’opérette de biopouvoir sécuritaire,
de zone grise d’indistinction qui nous fait toucher du doigt l’état
d’exception dont parle Agamben, nous n’avons pas trouvé de meilleure
coulisse que de répondre par écrit qu’encore assujettis au
nul n'est censé ignorer la loi, ce document ne rencontre aucune
des figures légales de dérogation du secret professionnel.
A sa suite, nous assistons à un premier effet dramatique : après
ce courrier la voix acousmatique se tait.
Lorsque
nous évoquons cette situation avec Alcina, elle insiste avec beaucoup
d’appréhension pour que nous restions à tout prix en dehors
des rouages d’une justice dont elle a tellement de raisons de se
méfier. Gagnés par une certaine appréhension, nous
décidons de publier l’ensemble de la proposition dans les pages
de L’Information psychiatrique [11], car en 2004 nous étions loin
d’imaginer qu’on arriverait à assister à la construction
d’ « hôpitaux-prisons », qui réduisent rétroactivement
notre convention au rang de parodie burlesque. Mais le prix pour notre
patiente est que la tension psychique créée par la nouvelle
situation atteint son paroxysme, et nos médicaments demeurent impuissants.
Soudainement, rideau ! Après une cure de thalassothérapie
prescrite par son médecin généraliste, elle ne revient
plus en consultation, et nos courriers, soucieux et bienveillants, restent
sans réponse.
Revendication
et autopunition
D’un
point de vue psychopathologique, nous pourrions jusqu’ici avancer l’hypothèse
que, malgré ses efforts, notre patiente n’a pas frappé suffisament
le kakon de son être, comme le dit Lacan à la suite de Paul
Guiraud. C’est notre principale inquiétude concernant sa disparition
de la scène. Retournons un instant aux années 1930, puisque
la question de l’autopunition est dans l’air du temps. Cette même
année, Angelo Hesnard et Paul Lafargue présentent un Rapport
dans le cadre de la V° Réunion de psychanalystes de langue française
[8]. Déjà, dans la lignée du psychanalyste Alexander,
ils insistent sur l’importance de ce mécanisme dans la genèse
des nommées réactions sociales morbides, parmi lesquelles
les vols saugrenus et les crimes. Ils consacrent un chapitre à la
question de l’autopunition dans les psychoses, mais mis-à-part la
mention du suicide dans la mélancolie, il n’y a aucune référence
au passage-à-l’acte. L’essentiel de ce rapport peut être condensé
dans une phrase des auteurs : « Après la punition, détente
et le droit de vivre ». C’est ce dont se prévaut Lacan dans
sa thèse pour la variété de paranoïa qu’il entend
définir. Son ambition est celle d’ajouter une nouvelle forme à
celle décrite sous le nom de « paranoïa de revendication
». Comme dans une tragédie, dans cette nouvelle variété
c’est l’acte du sujet qui fait basculer de la revendication à l’autopunition.
Mais, il faut noter que tragédie implique sacrifice, et le protagoniste
sacrifie sa vie terrestre pour La Chose, de façon telle que sa défaite
est son triomphe. Lacan affirme que revendication et autopunition sont
animées par la même intention punitive, mais que leur économie
énergétique est inversée : la tendance concrète
peut ainsi avoir des manifestations opposées.
Le
retour sur scène d’Alcina en bonne dialecticienne va nous montrer
que, grâce à un nouveau renversement de la tendance concrète,
il est possible de sortir de l'impasse ou lui ou moi, par une implication
sociale encore plus originale de l’Autre souverain, à travers une
des fonctions les plus essentielles à son pouvoir : sa capacité
à suspendre la loi, à montrer par là son statut d’exception,
à accorder la grâce. Dans ce nouvel renversement possible,
la comédie met en scène le triomphe de la vie indestructible,
non la vie sublime, mais la vie terrestre elle-même. Cette fonction
du souverain n’a échappé ni à Mozart pour ses opéras,
ni à Agamben pour son analyse, qui la fait voir comme une fiction
destinée à dissimuler que « la double machine gouvernementale
» [2], c’est à dire sa rationalité politico-juridique
et celle économico-gouvernementale, n’ont entre elles aucune articulation
possible, et que de ce problème dépend la destinée
de ce que l’on entend par démocratie...
La
paranoïa de grâce
Lors
du dernier acte de notre relation thérapeutique avec Alcina, nous
saisissons à quel point une mimèsis opératique est
à l’oeuvre dans la nouvelle variété clinique qu’elle
est en train d’inventer. Elle revient à la consultation un jour
d’août 2004 parée de ses lunettes noires, souriante, détendue
et bronzée, pour nous dire qu’elle va bien, et qu’elle part dans
les jours qui viennent pour une nouvelle vie dans le sud de la France.
Ce qui lui a permis de prendre cette décision est que pendant le
mois de juillet précédent elle a été reçue
en audience par une des assistantes de la justice, pour se voir communiquer
une décision la concernant. Exerçant de façon souveraine
une fonction héritée des temps lointains, le Président
de la République d’alors, un homme rendu populaire par sa marionnette
qui conseillait de manger des pommes, véritable personnage de comédie
médiatico-spectaculaire, venait de gracier Alcina le 14 juillet.
Le lamento d'Alcina avait atteint ainsi les plus hautes sphères
du pouvoir souverain, mais, contrairement à la paranoïa d’autopunition
à dénouement tragique, elle reçoit la grâce.
Un lieto fine qui complète et dépasse les formes cliniques
précédentes présentées par Lacan : de la paranoïa
de revendication, en passant par la paranoïa d’autopunition, jusqu’à
la paranoïa de grâce, inventée par notre patiente. Elle
la réussit d'un tour supplémentaire par l’Autre souverain,
dans un temps où le droit de vie et de mort, comme le dit Michel
Foucault, s’est renversé dans le « faire vivre et laisser
mourir » [7] de la biopolitique contemporaine.
Revenant
sur la psychopathologie, la logique à l’oeuvre dans l’épopée
d’Alcina mérite d’être comparée à celle déjà
remarquée par Henri Ey [6] et revisitée par Jean Claude Maleval
[12] : le moment du consentement à la jouissance de l’Autre. La
forme clinique abordée par Ey et Maleval, à la suite de leur
célèbres prédécesseurs classiques, est la paraphrénie,
qui fait cesser toute persécution par un renversement de la position
subjective dans la mégalomanie. D’après Maleval, bien des
années après son cas Aimée, Lacan suggère une
innovation nosographique lorsqu’il évoque la notion de « paraphrénie
imaginative » à l'occasion d’une présentation de malades,
variété méconnue des classiques, mais assez proche
des délires d’imagination de Dupré et Logre. Le sujet paraphrène
consent à la jouissance de l’Autre, avec qui il se réconcilie
à travers la mégalomanie qui soutient son identité
d’exception. Dès lors, incarner l’exception constitue une manière
de témoigner de la fonction d’un manque, puisque celle-ci se supporte
d’un élément qui décomplète le Tout, en le
garantissant comme constructible. Et en ce sens, dit Maleval, l’exception
confirme la règle. Elle trouve sa place dans un no man’s land entre
droit et fait, comme le dit Agamben [1].
Si
nous tenons à distinguer imaginaire et imagination, c’est que cela
nous montre avec clarté que dans le cas d’Alcina la trame ne se
déroule pas dans le seul espace subjectif, et que par son amour
un peu fou pour les figures d’exception et la force d’imagination de son
lamento elle mobilise les instances politiques les plus concrètes
de l’Etat. Comme dans un opéra que Mozart mettrait en musique, à
la fonction du Souverain, qui excerce sa position d’exception vis-à-vis
des lois, Alcina oppose preuves à l’appui la certitude d’être
l’exception qui confirme la règle, grâce aux plus hautes autorités
souveraines. Il ne lui reste donc qu’à consentir à la grâce
de l’Autre, moins prestigieux que ceux des grands opéras, mais non
moins souverain.
Ritournelle
Après
ce dénouement nous ne l’avons plus revue. Notre surprise fut à
la hauteur des événements. A l’époque, l’ouvrage d’Agamben
venait de paraître dans les librairies et, de rapport en rapport,
l’atmosphère de l’assistance psychiatrique commençait à
se raréfier. A peine croyable, cette histoire nous rappelle simplement
que le fait politique et le fait psychiatrique sont depuis toujours étroitement
liés, aussi bien dans ses manifestations cliniques que dans l’assistance
thérapeutique. Ceci reste vrai même à l’époque
de l’hégémonie a-théorique et de la gouvernance post-politique.
Mais surtout, ce que l’histoire d’Alcina montre c’est qu’il est possible
de dépasser le scepticisme cynique qui a tendance à nous
envelopper. A l’heure où l’état d’exception généralisé
dénoncé par Agamben favorise le surgissement de toutes sortes
de dispositifs biopolitiques, des camps jusqu’aux marquages biométriques,
Alcina prouve par son « imagination nosographique » qu’il est
possible de trouer le maillage. Nous voudrions nous en inspirer pour ne
pas trop ressembler aux assistants kafkaïens épinglés
par Benjamin. Particulièrement au moment où les nombreux
assistants de notre société du spectacle, qui ont leurs propres
idées sur les liens à établir entre politique et subjectivité,
continuent leur ritournelle : the show must go on !
BIBLIOGRAPHIE
1)
GIORGIO AGAMBEN, Etat d’exception, Seuil, L'ordre philosophique Paris :
2003.
2)
GIORGIO AGAMBEN, Note liminaire sur le concept de démocratie, in
Démocratie, dans quel état ?, La Fabrique Editions, Paris
: 2009.
3)
LOUIS ALTHUSSER, Idéologie et appareils idéologiques d’état,
in Positions, Editions sociales, Paris : 1976.
4)
WALTER BENJAMIN, Franz Kafa, in Oeuvres II, Folio Essais Gallimard, Paris
: 2000.
5)
MICHEL CHION, La Voix au cinéma, Editions Cahiers du Cinéma,
Paris : 1982.
6)
HENRI EY, Traité des hallucinations, Masson, Paris : 1973.
7)
MICHEL FOUCAULT, Histoire de la sexualité, Vol I, La volonté
de savoir, Gallimard, Paris : 1976.
8)
ANGELO HESNARD, RENE LAFORGUE, Les processus d’auto-punition, Psychanalyse
et civilisation, L’Harmattan : 2001.
9)
ERNST KRETSCHMER, Paranoïa et sensibilité, Presses Universitaires
Françaises : 1963.
10)
JACQUES LACAN, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la
personnalité, Seuil, Paris : 1975.
11)
EDUARDO MAHIEU, Des soins d'exception, L'Information psychiatrique, Vol
80, N°6, juin juillet 2004, p. 441.
12)
JEAN CLAUDE MALEVAL, Logique du délire, Masson, Paris : 1996.
13)
IVAN NAGEL, Autonomie et grâce. Sur les opéras de Mozart,
Editions de l’aube : 1990.
14)
JEAN STAROBINSKI, Les enchanteresses, Editions du Seuil, Paris : 2005.
15)
THIERRY TREMINE, En attendant le client, L’Information Psychiatrique, 2006,
82 : 451-3.
16)
SLAVOJ ZIZEK et MLADEN DOLAR, Opera’s second death, Routledge, London-New
York : 2002.
17)
SLAVOJ ZIZEK, The parallax view, Massachusetts Institut of Technology Press
: 2006.
