
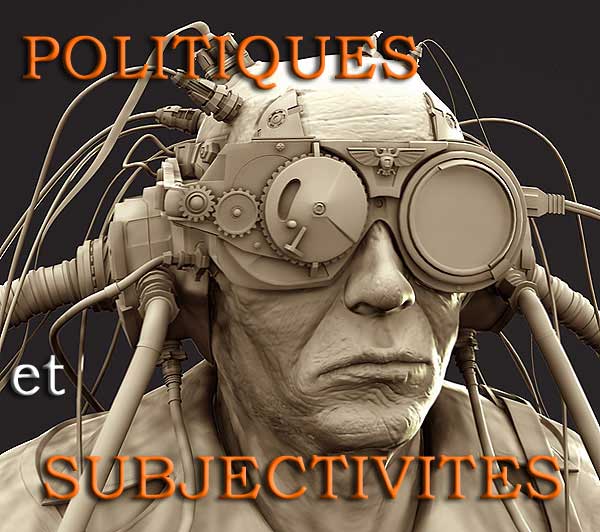
Mercredi
10 JUIN 2009 de 9H à 17H
MAISON
DE L’AMERIQUE LATINE
217,
Boulevard Saint-Germain, Paris, 75007
REPONSES
A L'IM-POLITIQUE DES URGENCES SUBJECTIVES
GUILLERMO
BELAGA
1-
Je vous remercie de me donner l'occasion de témoigner de l'expérience
que nous réalisons actuellement dans un hôpital public de
la banlieue de Buenos Aires, orientée par la pratique de la psychanalyse.
Cette
action se déploie à une époque où la chute
des programmes institutionnels se vérifie, ceux que la modernité
avait instaurés pour traiter et éduquer la population. Des
programmes dont le support était une Autorité universelle
qui pouvait établir un pacte symbolique garant de la socialisation
et de la subjectivité des personnes.
Tout
d’abord, avant d'évoquer cette expérience, je ferai une brève
description du Service de Santé mentale dont je suis responsable.
Ce service fait partie d'un hôpital général de pointe
dans la commune de San Isidro dont la population est de 300 000 habitants.
Il est le centre de référence du système local de
santé, qui compte également deux autres hôpitaux, l'un
tourné vers l’enfance et la maternité, l'autre également
général mais de moindre envergure, ainsi que neuf dispensaires.
Toutes ces structures disposent d’un service de santé mentale.
Le
service assure 2500 consultations par mois, dont la plus part sont ambulatoires.
Ses principaux domaines d'action sont la consultation externe, où
sont proposées des thérapies individuelles, familiales et
de groupe, la psychiatrie de liaison et les ateliers de réhabilitation.
Il existe aussi une coopérative de travail et une maison relais
qui participe à un programme de désaliènation avec
un des principaux hôpitaux psychiatriques de la province de Buenos
Aires. L'hôpital n’a pas d’unité d'hospitalisation, même
si en cas d'urgence, les patients peuvent sans obstacles être accueillis
par les urgences générales. Pendant leur séjour est
mis en place rapidement un dispositif dont le but est d'établir,
d’amplifier et de renforcer le réseau communautaire, pour éviter
aux patients un séjour dans les hôpitaux psychiatriques. Ces
derniers sont des centres de soins avec plus de 1000 lits, éloignés
de la commune, ce qui brise davantage le lien social, déjà
affecté par la crise.

2-
De façon générale, en Argentine, l'hôpital public
est gratuit, c’est une institution reconnue et que la population s’est
approprié. C’est ainsi surtout depuis les années 50, quand
un plan sanitaire s'accordant à l'idée d'un État bienfaiteur
fut mis en place, permettant un meilleur accès aux soins pour la
population. Cet événement instaura au sein de la population
la culture d'un droit à la santé garanti par l' État.
Ce
fait concernant l'identité sociale de la population, fait encore
préservé aujourd'hui malgré les changements politiques
et sociaux, implique que personne ne puisse être en mesure d'utiliser
politiquement un discours qui nierait que les hôpitaux continuent
d'être publics, sans risquer une forte désapprobation.
3-
Le programme institutionnel de l'État a subi un grand revers à
partir des années 70 avec la dictature militaire, mouvement amplifié
par la suite dans les années 90, tout comme les identités
sociales qui s'étaient construites autour de l'emploi stable et
de la culture de l'économie «fordiste».
Ainsi,
à partir de ces années, la fragmentation de l'Autre s'est
approfondie, les "modes de vie" de jadis et / ou les"identités culturelles"
ont été affectées. Lors de ces décennies, se
sont effondrées les trames qui reliaient les idéaux sociaux,
culturels et politiques, éléments d'une bio-narration qui
ne purent continuer à donner du sens aux sujets. Par effet du nouveau
discours hégémonique du capitalisme mondial, comme sous d’autres
cieux, on parvient à se réfugier dans des identifications
plus instables, plus "faibles".
En
Argentine, cette irruption eut lieu en 2001. Ce n’est pas tant que les
effets d'un monde régi par la technologie et le discours capitaliste
– tel qu’il est décrit par J. Lacan en tant que nouvelle modalité
de jouissance qui ne trouve pas de défense possible-, ne soient
plus là, mais l'événement impolitique, l'irruption
de la pulsion de mort comme expérience collective a été
subjectivée à ce moment-là.
La
crise du modèle économique néo-libéral que
notre pays a vécu en 2001 a marqué un avant et un après
dans notre vie quotidienne, sociale et politique.
C'est
à cette période qu’à l’hôpital eut lieu une
situation qui a marqué le début d'un autre regard sur la
façon dont l'institution devrait répondre. Ainsi, dans ce
contexte d'incertitude, d'angoisse et de violence, un jeune blessé
a été amené par ses camarades au service de garde.
C'était une urgence médicale qui fut prise en charge sans
délais, mais pendant que ceci avait lieu, les mêmes jeunes
qui accompagnaient le blessé se sont attaqués aux installations
du service de garde et ont agressé les personnes présentes.
C'est
à partir de ce cadre chaotique d' "urgences subjectives »,
que nous avons commencé à repenser quelle institution pourrait
être à hauteur du réel sans loi.
Nous
avons compris comment la science et la technologie, alliées à
la mondialisation économique, produisent une crise d'autorité,
en termes de légitimité et de garantie, ce qui conduit
à une angoissante quête de références, ce qui
a une influence sur la pratique du personnel soignant – et c'est la raison
de cet écrit - mais qui s'étend aussi à l'ensemble
de la société.
La
conséquence de cela est qu'on ne peut plus soutenir « L’institution
» à partir d'identifications uniquement verticales. Il convient
de parler « des » institutions, de penser que tout, institutions,
lois, visions du monde sont provisoires, transitoires, qu’elles sont dans
une dynamique constante et peuvent être éventuellement transformées
de fond en comble à partir d'une pragmatique qui puisse considérer
que l'universel est percé par un réel indicible.
4.
Premiere reponse de la psychanalyse dans l’institution : la conection entre
la notion d'autorité et les stratégies de décision
L'orientation
psychanalytique nous a permis de repenser la notion d'autorité et
de la relier à un aspect fondamental de la pratique clinique: Les
stratégies de décision face à la demande du malade.
Alexandre
Kojève distingue quatre formes de l'autorité tout au long
de l'Histoire :
L'autorité
du Père sur le fils, du Maître sur l'Esclave, du Chef sur
la bande et celle du Juge sur celui ou ceux qui sont jugés.
À
leur tour, ces types sont articulés à d'autres formes d'autorité:
-
L'autorité du Père, à la tradition.
-
L'autorité du Maître, à celle du Noble.
-
L'autorité du chef, à celle du Supérieur hiérarchique.
-
L'autorité du juge, à celle du Confesseur
C’est
un fait : dans le contexte actuel on peut ressentir le déclin de
l'autorité du père sur la famille et l'éducation.
Ainsi, le mythe oedipien, représentant la figure du Père
comme celui qui incarne la loi et dont la parole pourrait interdire et
distribuer la jouissance ainsi qu’établir une loi à son égard,
cette figure ne fonctionne plus comme un moyen de situer une interdiction,
une limite.
Ce
que l’on constate maintenant c'est qu’il n'y a pas de limites. Il semblerait
que rien ni personne ne puisse poser une limite. Ceci atteint le pouvoir
de la parole. Ce pouvoir est érodé au point que, si les psychothérapies
comptaient sur la parole pour apaiser les tensions érotico-agressives
de l’imaginaire, c’est maintenant l’Image qui prend le dessus sur le symbolique.
5.
Quoiqu’il en soit, c’est la parole qui institue un espace et une temporalité.
Une institution, qui puisse loger sans obstacles bureaucratiques l’urgence
subjective et faire fonctionner l’Autre du langage dans les registres de
l'espace et du temps, demeure donc indispensable. Elle est fondamentale
pour la résolution du vide panique qui se produit pour les masses
lorsque toutes les garanties tombent.
Un
fait qui ressort maintenant, à l'époque du déclin
du Maître et du Père, est la façon dont la justice
et la religion apparaissent comme lieux de la Vérité, au-dessus
des autres formes d'Autorité.
Le
Droit tente de donner une réponse au phénomène fréquent
du soupçon. Bien qu’il ne puisse éviter d'être insuffisant
face à la violence.
La
religiosité, prend de plus en plus une place importante dans les
liens communautaires. Son succès se résume à fournir
une identité qui rend lisible l'existence des personnes dans ce
contexte d’ "errance" subjective.
6.
Face à la demande de réponses de celui qui souffre d’une
« urgence », il n’est plus possible d’incarner l’Autorité
sous les espèces des idéaux traditionnels, qui incarnaient
aussi une certaine façon de décider. Maintenant, nous considérons
que dans notre travail quotidien, qui consiste à établir
une action pour résoudre le «trauma généralisé»,
il faut repenser les stratégies de décision à la lumière
des nouveaux contextes.
A
l’analyse de certains postulats utilitaristes, il y a trois formes de choix
rationnel :
a.
Décision avec certitude
b.
Décision avec risque
c.
Décision avec incertitude
De
cette manière, on pourrait conclure que dans la plupart des cas
les thérapeutes doivent se positionner en sachant que la décision
comporte un risque.
7.
Ces approches tienent compte des conséquences sur la pratique quotidienne
de la mondialisation ainsi que des différentes stratégies
pour appréhender et opérer dans le cadre des nouvelles conditions
qui se développent et qui traversent les différentes identités,
à la fois dans leur continuité comme dans leurs ruptures
et leurs hybridations.
À
cet égard, Ernesto Laclau, attribue à l'hétérogénéité
un rôle constitutif dans le social.
Pour
Laclau, l'une des caractéristiques qui définissent
l'hétérogénéité est la dimension de
totalité manquée.
Par
conséquent, toute décision prendrait comme point de départ
l'exception et non la gestion de normes universelles. En outre, le moment
de la décision ne correspond pas au savoir total, mais la décision
repose sur un indécidable, et c’est suite à l’acte que l’on
sait.
8.
Ce contexte hétérogène fait échouer les algorithmes
décisionnels proposés par le modèle DSM, qui prétend
être capable d'établir un standard "pour tous".
En
outre, l'échec de ce programme traumatise le thérapeute,
et la surprise de la contingence est l'une des causes de l’angoisse du
praticien.
Cependant,
il est possible d'examiner à partir d'une autre praxis les postulats
qui tendent à l'homogénéisation des sujets. A partir
de l'enseignement de Lacan, la pragmatique de la psychanalyse part du principe
qu'il y a un trou dans l'Universel, et et que le symbolique trouve une
limite dans un réel impossible dont témoigne chaque
patient, un par un.
Cette
pragmatique implique un exercice de conversation, et d'abduction qui prend
en compte la contingence et le possible dans un contexte qui se traduit
dans l'organisation quotidienne par une approche du cas « à
plusieurs », en particulier dans le cadre de la garde et de la consultation
de liaison en urgence.
Sur
le même mode, n’oublions pas que le désir de l’analyste es
un désir de non-action, opposé au monde de l’utile, qui rend
possible la manœuvre pour pousser l’Autre à décider par lui-même.
9.
Second reponse de la psychanalyse dans l’institution : le passage du symptôme
social au symptôme particulier
J.Alemán
soutient que Freud n’a jamais nommé la civilisation qui serait la
plus pertinente pour l’être parlant, Mais par contre, Freud a prévenu
que si celle-ci reposait sur la satisfaction d’une minorité et n’offrait
pas à la majorité les ressources pour affronter les exigences
de la pulsion, cette civilisation deviendrait insoutenable.
Nous
pourrions en déduire que l’objectif de la psychanalyse à
l’hôpital serait d’aller à contre-courant de cette misère
subjective, serait de prendre en considération que « ce donr
on dépouille les multitudes, c’est de la possibilité de faire
l’expérience inconsciente du vide de la Chose que le surmoi comble
avec sa circularité pulsionnelle », avec son impératif
de jouissance.
La
misère, en ce sens, est celle d’être seul avec la jouissance
de la pulsion de mort dans l’éclipse absolue du symbolique. (7)
Dès lors, la clinique de l’acte analytique dans l’hôpital
public a pour horizon l’invention d’une nouvelle relation avec le surmoi,
dont elle cherche le démontage en passant par la grammaire pulsionnelle
de l’inconscient. En définitive, dans les témoignages cliniques
que nous avons étudié, la satisfaction se connecte
au traitement, l’effet thérapeutique atteint avec le passage du
symptôme social au symptôme particulier. Vérifiant ce
qu’affirme Lacan, que jouir de l’inconscient est toujours particulier,
et que c’est une sortie du symptôme social. (8)
10.
La logique de la cure dans l’ hopitaux :
Sans
doute sommes-nous en présence d’une « pulsion désarrimée
du signifiant » comme le décrit Eric Laurent, où aucun
discours ne paraît avoir la possibilité de se soutenir. (10)
Ceci nous fait signaler qu’à l’horizon, le péril d’un maître
des paroles et des corps pourrait advenir. Cette perspective nous a semblé
fondamentale dans notre orientation, déjà que que d’un côté
nous tenons compte du fait que l’expérience analytique ébranle
le fantasme, qui appelle un maître pour obturer la faille dans l’Autre,
et d’un autre côté, nous misons sur la mise en fonction de
quelque semblant qui permette de nouer le pulsionnel à la langue
commune.
C’est-à-dire
que, chaque fois, on tente un bon usage de l’aliénation, des rares
signifiants maîtres afin que le sujet construise une relation de
respect vis-à-vis de cette langue publique qu’incarne l’hôpital,
et qu’au même moment celui-ci devienne un instrument qui renvoie
à la propre histoire, à la languie privée de chacun
pour permettre un autre subjectivation de la vie.
Pour
conclure, nous le disions, la logique des cures pourrait se situer à
partir de la paire aliénation – séparation.
Ainsi,
l’aliénation - considérée comme la confrontation avec
une identification (S1), et l’inscription du sujet dans l’Autre -, a d’évidentes
manifestations dans la clinique de l’hôpital. On doit son efficacité
à la tendance « naturelle » du sujet à s’identifier,
mais aussi par le fait que l’identification aliène le sujet au lieu
de l’Autre dans la recherche de son être. Nous obtenons dans ce cas
un solde thérapeutique à la mesure du capitonnage dans un
moment d’indétermination subjective.
Ces
effets du S1, de l’opération d ‘aliénation, se connectent
avec la fonction de l’hôpital public comme garantie, inscrite dans
l’Autre social.
Du
point de vue de la psychanalyse, il y a un moment où le parcours
de la cure ouvre une tension avec le statut social de l’hôpital,
car le calcul de l’interprétation et la chute des identifications
déplacent le Nom du Père au champ de l’Autre sans garantie.
Dans ce sens, ce qui oriente le psychanalyste repose sur l’évaluation
de ce que le sujet peut supporter dans les deux pôles de son action.
L’opération
de séparation, pour Lacan, correspond à l’opacité
du désir de l’Autre, à l’inscription de l’objet a. C’est
là qu’apparaissent les inerties majeures dans les cures institutionnelles,
c’est une temporalité qui prend en compte davantage le libidinal
que le champ de l’Autre. Dans ce sens, la rencontre avec la honte, mais
aussi avec le transfert négatif ont éclairé cet aspect.
Par exemple, la présence de la honte a pu être déduite
d’un cas qui n’a pas voulu continuer à l’hôpital lorsque la
cure avançant, l’institution apparût comme la continuation
du ravage familial.
C’est-à-dire
qu’ici, nous sommes davantage dans le traitement de la relation d’extimité
que le sujet entretient entre son plus-de-jouir et l’Autre social. (11)
De
la même façon, dans la pratique analytique, la honte est un
indice du transfert. Se marque ainsi un autre vecteur où le thérapeute
devra être averti de ces effets, et l’institution devra supporter
le propre de l’acte analytique. Car cela tend à réveiller,
à « rendre honteux », et par là, cela peut mener
l’expérience à un point où peut-être l’analyse,
si sa mise s’accomplit, devra se poursuivre dans un autre contexte, hors
du champ « public ».
11.
Conclusion : Alors, pour nous qui pratiquons dans les hôpitaux à
partir d’une orientation psychanalytique, il existe une tension entre une
pratique qui essaie d’être une base d’opérations contre la
Malaise dans la civilisation, et à la fois qui s’efforce de ne pas
rester attrapée par la résolution de demandes sociales comme
n’importe quelle autre technique d’adaptation. Ce problème fût
explicité par Lacan en 1946 dans son éloge à Bion
et Rickman, lorsqu’il définit que la psychanalyse comporte une dimension
d’effectivité sociale quand elle se présente comme un instrument
de lutte contre la mort qui opère dans la civilisation. Sur ce mode,
nous allons tous les jours à notre institution disposés à
méditer une éthique qui conjugue le particulier articulé
aux valeurs de la société.
Merci
beaucoup.
BIBLIOGRAPHIE
1
Kòjeve, A.: La noción de autoridad- 1ª ed. - Buenos
Aires : Nueva Visión, 2005.
2
Laurent, E.: El tratamiento de la angustia postraumática: sin estándares,
pero no sin principios- La urgencia generalizada: ciencia, política
y clínica del trauma- 1ª ed.-Buenos Aires: Grama ediciones,
2005. pp. 31-49
3
Höffe, O.: Estrategias de lo Humano- Ed. Alfa- Buenos Aires, 1979.
4
Laclau, E.: Debates y combates: por un nuevo horizonte de la política-
Fondo de Cultura Económica- Bs.As., 2008
5
Alemán, J.: Nota sobre una izquierda lacaniana- Pensamiento de los
Confines Nº 20, junio de 2007 – Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica.
6
Alemán, J.: El legado de Freud- Revista Lacaniana- Año 4,
Nº 4, 2006. pp 19-23
7
Alemán, J.: Nota sobre una izquierda lacaniana, op cit.
8
Lacan, J.: R.S.I. –clase del 18-02-75 (inédito)
9
Le Blanc, G.: Vidas ordinarias, vidas precarias -1ª ed.- Buenos Aires:
Nueva Visión, 2007
10
Laurent, E.: Blog-note del síntoma -1ª ed.- Buenos Aires: Tres
Haches, 2006. pp 110-111
11
Miller, J.A.: El Analiticón Nº2, “Extimidad”, Barcelona, 1987,
pp. 13-27
