Commentaires
sur
Dolor
país
Dominique
Wintrebert
5
novembre 2002 |
 |
Lorsque nous avons rencontré,
Diana Kamienny, Martin Reca et moi-même, tous les trois respectivement
vice-présidente, secrétaire-adjoint et président de
l’Association franco-argentine de psychiatrie et de santé mentale,
Diana Quattrocchi-Woisson il y a exactement six semaines, c’était
bien sûr pour faire connaissance. Mais nous avions aussi l’ambition
de voir quelles synergies, quels types de coopérations ou de partenariats
étaient envisageables entre nos deux associations. Nous avons alors
évoqué notre idée d’organiser un après-midi
ayant pour thème “ Crise sociale et psychopathologie ” pour lequel
nous avions le projet d’inviter Silvia Bleichmar. Nous eûmes la surprise
d’apprendre que nous avions été devancés et qu’elle
devait intervenir ici même, devant vous. Nous nous associons bien
évidemment aux regrets qu’a soulevés son absence et aux vœux
de prompt rétablissement qui lui sont destinés.
Silvia, je ne l’ai rencontrée
qu’une fois. C’était lors du Colloque sur “ l’effet mutatif
de l’interprétation psychanalytique ”. À l’invitation de
la revue Vertex, revue que j’ai créé avec mon meilleur ami
le Pr Juan Carlos Stagnaro en 1990, cette rencontre réunissait des
psychanalystes des différents courants, rompant en cela pour la
première fois avec le silence qui régnait depuis l’exclusion
de Jacques Lacan en 1964 par l’Internationale psychanalytique. Ce Colloque
se tenait à Buenos Aires en juillet 2000, et l’on peut dire que
l’Argentine y était à l’honneur. J’avais pu y mesurer le
franc-parler, la culture psychanalytique et l’intelligence de Silvia en
écoutant ses prises de position. Rappelons qu’elle est loin d’être
étrangère à la France puisqu’elle détient un
doctorat de psychanalyse de l’Université de Paris VII. Saluons le
courage de son engagement dans le mouvement de résistance des intellectuels
argentins, et le lourd tribut payé, certainement lié pour
une part à son engagement, qui lui interdit d’être parmi nous
aujourd’hui.
Parler du livre de Silvia,
c’est d’abord le dater précisément de ces évènements
de décembre 2001 en situant à quelle place se situe l’auteur,
c’est ensuite le présenter comme objet, c’est enfin parler de son
style et de son contenu.
Silvia écrit depuis
une place d’intellectuel critique, en d'autres temps, nous aurions dit
engagé, cherchant dans l’histoire ancienne et récente une
lecture des causes qui ont provoqué le naufrage argentin, examinant
les composantes de la désagrégation sociale, appelant à
une reprise en compte de l’éthique. Elle le fait avec une générosité
admirable et dans une langue simple, et l'on oublie quasiment à
la lecture de son écrit son métier de psychanalyste tant
la place des concepts apportés par cette discipline est discrète.
Nous allons commencer par
décrire ce livre comme l'objet qu'il est. Publié par libros
del Zorzal, il s’agit d’une édition au format de poche, sans ostentation
mais sans misérabilisme non plus, de 90 pages, plutôt un opuscule
ou un essai qu’un livre véritable. Neuf chapitres d’entre
six et quatorze pages le composent, faciles à lire. C’est typiquement
un ouvrage à emporter avec soi, à prêter ou à
offrir.
Arrêtons-nous
un instant sur la couverture. C’est une photo de Pablo Galarza dont il
faut admirer l’à-propos. Elle représente la fameuse Place
de Mai de Buenos Aires avec en toile de fond la Maison rose, nom donné
au palais présidentiel. La place est déserte et l’on imagine
plutôt l’aube que la tombée du jour. Le rose du Palais est
la seule couleur émergente dans cette aube encore indécise
où tout se dessine dans les tons gris. Au premier plan gisent une
casserole et son couvercle, les deux cabossés par une utilisation
que l’on devine frénétique. Cette casserole vide devenue
le symbole d’une révolte de masse contre la classe dirigeante figure,
ainsi posée en miroir de la Casa rosada, la faillite du pouvoir,
la gamelle vide du peuple. Enfin, un vol d’oiseaux, rendus légèrement
flous par l’exposition nécessairement lente de la photographie,
traduit on ne sait quel signal de départ sur cette place vidée
de toute âme qui vive. Ces oiseaux, au nombre de douze, représentent
le seul mouvement perceptible. Sont-ils sortis de cette casserole, boîte
de Pandore moderne, comme autant de maux qui rongent l’Argentine ? Ou plutôt,
un dernier cacerolazo les aura-t-il chassés ? Est-ce la métaphore
d’une migration qui va laisser la place définitivement déserte,
évoquant le tag fameux de l'aéroport de Montevideo à
l'époque des Tupamaros, "le dernier qui part éteint les lumières"
? Tout le livre va contre cette idée, appelant les Argentins à
ouvrir une nouvelle page de l'histoire argentine.
|
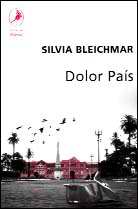
|
Le titre du livre,
Dolor Pais, est un contrepoint au fameux "risque pays", indice calculé
par la finance internationale pour mesurer les risques encourus par les
investissements et qui avaient mis l'Argentine à égalité
avec les pays africains les plus corrompus. L'indice "douleur pays", somme
des souffrances endurées par le peuple, est tiré d'un article
du Clarin du 25 juillet 2001.
Entrons maintenant dans
le corps du livre.
Argentine, pays de faconde
et de superbe, pays de l’enfant roi, pays aux ressources inépuisables
au point que l’on pensait, il y a un siècle, qu’elle allait devenir
les Etats-Unis d’Amérique latine, l'Argentine, est à genoux,
affamée. Elle que justement on aurait crue à tout jamais
à l’abri de la famine tant la Pampa faisait figure de corne d’abondance,
l'Argentine a faim et c’est une des premières réflexions
frappantes du livre de Silvia Bleichmar, l’appel à un souvenir d’enfance,
une phrase souvent entendue — “ Como se nota que este pais no tuvo hambre
ni guerra ”. Ce souvenir d’enfance refaisant surface avec la teinte un
peu grise que lui donnent les événements récents n'est
pas sans évoquer les immigrants chassés de leurs terres d'origine
par les guerres et les famines. En cinquante années, l'Argentine
a perdu ce statut de terre favorable à l'asile, connu la guerre
dite "sale", puis la guerre des Malouines, ses enfants et ses personnes
âgées ont faim, et tous les indices de santé publique
sont catastrophiques. Peut-on parler pour autant, comme le fait Silvia,
d'un désir mortifère d'identification aux parents ?
Le livre débute ainsi
sur la prospérité perdue et passe en revue les cinquante
dernières années, cherchant à identifier et doser
les responsabilités. Est rappelée la place singulière
des militaires dans la conduite des affaires de la nation, leur immoralité
civique, allant jusqu'au crime organisé. Leur rôle n'est évidemment
pas mis au même rang que ceux de politiciens plus ou moins corrompus,
menteurs et inefficaces. Ici, Silvia quitte le champ idéologique
et politique pour celui des formes de fonctionnement de la subjectivité.
Elle étudie alors en les distinguant l'agressivité qui reconnaît
l'autre, le sadisme qui essaye de destituer la subjectivité de l'autre
au profit de la propre jouissance du sujet, la cruauté qui mêle
les deux et dont la torture est le paradigme. Elle enchaîne sur une
référence à Hanna Arendt qui est une des pointes du
livre. Il s'agit d'un mode d'opérer qui n'a rien de sadique, agressif
ou cruel et qui pourtant produit les mêmes effets par le simple fait
d'ignorer l'autre et sa souffrance. C'est ce que Hanna Arendt a appelé
"la banalité du mal", pure indifférence à ce que l'autre
subit, la victime ayant cessé d'être notre semblable. (p.18).
Le premier chapitre
se termine par une référence à une page de l'histoire
argentine, la victoire de Liniers contre les anglais qui permit au peuple
de se faire à l'idée de se libérer de la tutelle espagnole,
et bientôt conquérir son indépendance. L'idée
de Silvia est qu'un mouvement du même ordre est aujourd'hui nécessaire,
et pour cela, il faut définir des critères non seulement
économiques mais aussi représentationnels.
|

|
Suit tout un développement
sur ce que représente l'indice qui donne son titre au livre. On
y trouve des réflexions qui sont tirées de la psychanalyse
des enfants. Quand ceux-ci sont laissés sans réponse humanisée
à leurs appels, ils peuvent entrer dans un état de marasme
et peuvent se laisser mourir de désolation.
Nous trouvons ensuite un
chapitre intitulé "déroute de la pensée" qui met l'accent
sur la perte d'un héritage et d'un espoir, celui d'un monde meilleur,
et sur la carence d'un réflexion profonde sur la condition humaine
dans les circonstances historiques traversées par le pays pour dépasser
le malaise et restituer un futur possible.
L'exode actuel de toute
une couche d'intellectuels inquiète Silvia. Il n'est pas symptôme
d'une absence d'issue, mais de l'abandon de sa recherche. Elle note dans
la jeunesse un processus de désidentification, une perte des référents.
Elle cite une parole du Président De la Rua devant le succès
d'une équipe de football : "Ces garçons vont maintenant avoir
de bonnes opportunités à l'étranger", véhiculant
l'idée, partagée par la plupart que l'avenir est à
l'extérieur du pays. Dans le vécu de la jeunesse d'une triple
perte - du sentiment d'appartenance, d'identifications partagées,
de projections vers le futur - se profile un risque de déshumanisation,
de solitude et d'absence de recours. Deux dangers guettent le psychisme
soutient-elle : la perte des investissements liant le sujet aux semblables
et la désidentification de ses propres idéaux.
Pour dire l'état
du politique, au chapitre V, elle utilise une anecdote terrible. Un poulailler
industriel a licencié tous ses ouvriers, la multinationale se retirant
du pays. Les milliers de poulets abandonnés à leur sort et
livrés à une mort certaine se sont entretués. Silvia
en fait une "métaphore vivante du cannibalisme économique,
apportant le quota d'horreur nécessaire pour que les chiffres perdent
l'opacité derrière laquelle se cache la désespérance".
(p.48)
Une autre anecdote est plus
réjouissante. Le patron d'un restaurant a décidé de
fermer ses portes aux fonctionnaires gouvernementaux habitués des
lieux après un débat avec ses employés. Que dit-il
? "Cela ne va pas mal pour nous, mais nous voyons ce qui se passe autour
de nous et c'est comme gagner au poker sur le Titanic." Silvia se réfère
à Levinas pour en tirer la leçon : "L'intrusion de l'Autre,
du Prochain (…) produit un dérangement qui est ma naissance au scrupule."
L'autre, inscrit en nous, permet d'engendrer l'attente d'une rencontre
nouvelle avec la solidarité, et cette dépendance est le fondement
éthique de notre obligation envers le semblable.
La fonction créationniste
du langage au-delà de sa nature descriptive est mise en relation
avec sa fonction de stigmatisation au début du septième chapitre,
intitulé "Perdants et gagnants, entre excuse et justification".
Il s'agit d'une critique de ces deux termes, winners et losers, signifiants-maîtres
du capitalisme sauvage établissant une bipartition selon le succès
social. Silvia trouve cette classification d'une extrême immoralité.
Les victimes seraient responsables de leur marginalisation et de leur détresse
du fait de leur incapacité à s'adapter aux nouvelles circonstances.
Il ne s'agit plus ici d'être le gagnant d'une épreuve quelconque
mais bien d'être un gagnant, d'appartenir à l'espèce
ainsi constituée. Il s'agit par là même de rendre les
perdants responsables de leur sort. Pour en faire la démonstration,
Silvia s'appuie sur un travail d'Austin qui distingue excuses et justifications.
Le risque pour les perdants est d'une part celui d'une mélancolisation
par le retour de la haine sur eux-mêmes devant l'impossibilité
de s'affronter à quiconque, d'autre part de se voir engloutis dans
la masse des handicapés qui ne savent pas trouver d'issue.
Elle distingue alors l'auto-préservation
du moi, la façon dont celui-ci prend en charge la représentation
nucléaire de lui-même qui lui rend possible d'être aimable
et l'autoconservation du moi, celle plus classique selon laquelle il préserve
ses intérêts vitaux. Dans les situations de vie extrême,
l'autopréservation peut être profondément atteinte
et pour la maintenir, l'autoconservation peut être sacrifiée
en vue de ne pas céder sur des enjeux sans lesquels la vie perd
son sens.
S'ensuit une référence
au film Matrix pour situer l'enjeu actuel de la société argentine,
qui mène aux deux derniers chapitres, véritable profession
de foi. L'Argentine est devenue un pays de recyclage, dans lequel tout
doit être repensé, chaque vie doit être considérée
comme précieuse, il faut démettre les corrompus et les incapables,
défaire les alliances misérables qui couvrent les délits.
"Nous avons gagné de perdre la pudeur d'être pauvres" nous
dit Silvia (p.90) et "cela nous permet de récupérer la dignité
d'être ce que nous sommes".
Voilà donc un livre
généreux, argumenté, combatif, écrit sans doute
dans la hâte, qui émane d'une collègue dont l'engagement
intellectuel et éthique est digne d'admiration. La référence
à la psychanalyse n'y apparaît qu'en filigrane et n'est jamais
dogmatique.
Sans doute, une reprise
du fameux article de Freud sur "la psychologie des masses" aurait-il permis
une mise en valeur plus construite du phénomène central qu'est
pour nous la corruption des dirigeants pour rendre compte de la désagrégation
sociale.
On regrettera que le choix
de l'Axe lors de la Deuxième Guerre mondiale par les militaires
déjà au pouvoir ne soit pas abordé, et qu'un espace
plus important ne soit pas donné à la terrible invention
de la dictature : les disparitions de masse. C'est ainsi que le rôle
de la Place de Mai comme territoire de révolte et de dignité
gagnée sur la répression et l'impunité est souligné
beaucoup plus avant dans le livre, mais sans être rapporté
à celles qui l'ont fait connaître internationalement par leur
courage, les dites "folles", folles d'oser se lever contre un régime
aussi barbare, folles de douleur par la perte de leurs enfants et l'impossibilité
d'effectuer les rites funéraires. La folie nous enseigne que ce
qui n'est pas admis dans l'univers du symbole fait retour dans le réel,
comme la peste dévaste Thèbes après l'injustice faite
à Antigone.

Et si la loi sur l'obéissance
due est rapportée par Silvia comme le plus haut degré de
déresponsabilisation, le "por algo sera" de sinistre mémoire,
dont il est dit qu'il refait surface à propos de la fausse dialectique
gagnants-perdants, n'est pas référé à la page
qui reste sans doute la plus noire de l'Argentine moderne.
Interrogeons-nous, pour
finir, sur la place à nulle autre pareille de la psychanalyse dans
ce pays, le livre de Silvia en étant un nouveau témoignage.
Il est vraisemblable qu'une des raisons majeures à même d'expliquer
son succès en Argentine tient à l'exceptionnel melting-pot
qu'était ce pays accueillant des immigrants aux origines et cultures
variées. Ces immigrants avaient traversé des évènements
de vie chaotiques, perdu leurs attaches, et leurs relations familiales
avaient été souvent chahutées. Il y avait donc, d'une
part, certaines fragilisations familiales et individuelles, d'autre part,
avec l'assimilation, la nécessité de trouver un terrain commun.
La psychanalyse était la plus à même d'offrir ce terrain
commun puisque sa doctrine suppose que nous sommes tous des exilés
de notre inconscient.
À l'époque
de la dictature, on a pu entendre un odieux parallèle entre le succès
qu'elle connaissait dans le pays et la survenue d'un tel régime,
comme s'il pouvait y avoir une solidarité entre ces deux mouvements.
L'inverse eut cours aussi bien et l'on suspecta la psychanalyse de connivence
avec le terrorisme. (cf. Vezzetti, Cuestionamos p.221).
Rappelons pour mémoire
qu'au début des années 70, un groupe d'analystes s'étaient
séparés du courant officiel, critiquant la façon dont
était pensée l'institution analytique, lui reprochant de
rester dans une pratique considérée comme bourgeoise et intimiste
de cabinet sans prendre en considération la situation sociale traversée
par le pays. Ce groupe intitulé Plataforma avait une visée
qui dépassait les frontières de l'Argentine, à la
différence de Documento, autre noyau de révolte, mais qui
était strictement argentin. L'on peut considérer a posteriori
qu'ils étaient dans le vent de l'histoire.
Pour aller plus avant dans
la réflexion que la psychanalyse peut apporter au drame argentin,
je vais tracer à grands traits quelques références
précieuses. Citons les conceptions freudiennes concernant la place
du père comme vecteur de l'interdit de l'inceste. Ces conceptions
s'originent de son livre Totem et tabou de 1912 qui esquisse une théorie
générale de la religion, dessinant les efforts des fils pour
prendre la place du Dieu-Père de la horde primitive, l'apparition
du sentiment de culpabilité qui en découle et les constructions
culturelles qui en procèdent. Le temps suivant est sa Psychologie
des masses en 1921. Il y démontre comment une foule veut toujours
un père de la horde comme idéal (Essais de Psychanalyse p.156),
et il oppose une foule organisée, dont le ressort est la croyance
d'un amour égal du leader pour ses sujets, à une foule en
guerre, ou simplement désorganisée, celle où le leader
perd sa fonction. Et là, certainement, le rôle de la corruption
des élites argentines est crucial.
Citons un passage de ses
"considérations actuelles sur la guerre et la mort" (Essais, p.241)
: "… Notre conscience, loin d'être le juge implacable dont parlent
les moralistes, est, par ses origines, de l' “angoisse sociale“ et rien
de plus. Là où le blâme de la part de la collectivité
vient à manquer, la compression des mauvais instincts cesse, et
les hommes se livrent à des actes de cruauté, de perfidie,
de trahison et de brutalité qu'on aurait crus impossibles, à
en juger uniquement par leur niveau de culture."
Il faudrait y ajouter son
Malaise dans la civilisation, qui, à partir de l'élaboration
de ses concepts de surmoi et de pulsion de mort illustre d'une façon
admirable et pessimiste les impasses du travail de civilisation lui-même.
On pourrait ici faire une
incidente sur les réflexions de Weber sur le pouvoir. Weber appelle
de ses vœux une position charismatique du leader soutenue par l'idée
d'une éthique de la responsabilité. Ce faisant, il rate la
bascule toujours possible de cette position vers le pire, bascule dont
l'Allemagne nazie a fourni l'illustration oh combien terrible que vous
connaissez.
Lacan constate que peu
d'hommes sont capables de résister à une dimension de sacrifice
à des Dieux obscurs. Lacan reproche à Freud de vouloir sauver
le père. Il va, avec l'écriture de ses quatre discours, reprendre
les conceptions freudiennes, rangeant sous la bannière du discours
du maître la construction freudienne du leader charismatique, et
sous celle du discours universitaire, celle des bureaucraties. Freud ne
pressent pas le déclin du père et l'évolution moderne
de la société vers des réseaux et des tentations communautaires
où nul centre ne prévaut plus. Cette évolution porte
en germe la montée des ségrégations, annoncée
par Lacan dans Télévision.
Voici donc quelques aperçus
pour ouvrir à la discussion.
|





